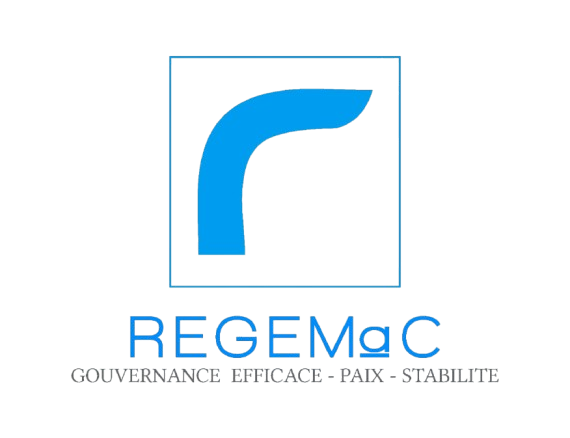Introduction
Un continent en mouvement : une réalité à double tranchant
L’Afrique, berceau de l’humanité, est un continent dont la majorité de la population est jeune, dynamique. Elle dépasse 1,4 milliard d’habitants avec une moyenne d’âge d’environ 19 ans. Avec cette population, l’Afrique détient un atout démographique inégalé. Pourtant, Paradoxalement, ce vivier de talents et de travailleurs reste inexploité pour la dynamisation de l’économie au point d’être l’Afrique est aujourd’hui confrontée à une situation préoccupante. Il s’agit de la migration massive de ses bras valides et de ses cerveaux ses forces vives vers d’autres horizons.
Ce phénomène n’est pas nouveau. Depuis des siècles, les Africains ont voyagé, échangé et migré, que ce soit pour des raisons commerciales, climatiques ou sociopolitiques. Mais la vague migratoire actuelle diffère par son ampleur, sa nature et ses implications profondes. Chaque année, des millions de jeunes Africains, diplômés ou non, quittent leurs pays d’origine en quête d’un avenir meilleur. Certains fuient la pauvreté et le manque de perspectives, d’autres sont poussés par des conflits politiques ou des crises environnementales, tandis que d’autres encore cherchent simplement à maximiser leur potentiel dans des environnements plus favorables. La migration est une réalité universelle qui concerne toutes les régions du monde." (Castles, de Haas & Miller, 2020)
Les conséquences de cette migration sont multiples. Si d’un côté, les transferts de fonds des migrants constituent une manne financière essentielle pour les familles restées au pays, de l’autre, la fuite des compétences et des bras valides risque d’affaiblir durablement le développement socio-économique durable du continent. Loin d’être une simple fatalité, cette dynamique interroge l’avenir durable de l'Afrique et sa capacité à retenir ses talents et ses forces vives. Contrairement à certaines idées reçues, la migration africaine ne se limite pas à l’exode vers l’Europe ou l’Amérique du Nord. Plus de 70 % des déplacements se font à l’intérieur de l’Afrique." (OIM, 2023)
À travers cette introduction, nous allons explorer le contexte de la migration africaine, en examiner les tendances statistiques, identifier les enjeux majeurs pour l’Afrique et les pays d’accueil, et enfin, présenter la problématique centrale de cet ouvrage ainsi que les objectifs poursuivis.
Chapitre 1 : Les causes profondes de l’émigration africaine
L’émigration africaine est un phénomène complexe et multidimensionnel, qui résulte de facteurs interconnectés et souvent profondément enracinés dans les structures sociales, économiques, politiques et environnementales du continent. La migration ne peut être comprise qu’à travers l’analyse des causes structurelles qui incitent les Africains à quitter leur pays pour chercher de meilleures opportunités ailleurs. Ce chapitre explore les principaux moteurs de l’émigration en Afrique, à savoir les facteurs économiques, politiques, sociaux, environnementaux, ainsi que l’influence croissante des diasporas et des réseaux sociaux.
1. Facteurs économiques : chômage, bas salaires, inégalités de développement
Les facteurs économiques représentent l'une des causes les plus profondes et les plus persistantes de l’émigration en Afrique. En raison de la pauvreté, du chômage élevé et de l'absence de perspectives d’avenir, de nombreux Africains sont contraints de quitter leur pays dans l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie. Ces défis économiques, souvent structurels, freinent le développement du continent et conduisent à une frustration croissante parmi les populations, en particulier chez les jeunes.
Le chômage et le sous-emploi des jeunes
L’un des facteurs économiques les plus influents derrière l'émigration africaine est le chômage, particulièrement celui des jeunes. Selon l'Organisation Internationale du Travail (OIT), plus de 60 % des jeunes Africains sont soit au chômage, soit en sous-emploi, un chiffre alarmant qui reflète l’ampleur du problème (ILO, 2021). Ce taux élevé de chômage des jeunes est un problème récurrent dans de nombreux pays africains. Par exemple, en Afrique subsaharienne, le taux de chômage chez les jeunes diplômés est particulièrement élevé, avec peu de perspectives d’emplois formels et de carrières. Cette situation est aggravée par le manque de formation professionnelle adaptée aux besoins du marché du travail.
Les jeunes diplômés, notamment dans des pays comme le Nigéria, le Cameroun, et le Maroc, se retrouvent souvent sans emploi, malgré leurs qualifications. Un exemple concret est celui des nombreux diplômés d’universités et de grandes écoles qui ne trouvent pas d'emploi correspondant à leur niveau d’études, ce qui engendre un sentiment de frustration et d’impuissance. En l'absence de débouchés professionnels, beaucoup choisissent d'émigrer pour trouver des opportunités à l’étranger, espérant y obtenir un travail plus stable et mieux rémunéré. Le chômage n'est pas seulement un problème économique, il est également un défi social, car il est perçu comme un frein au progrès personnel et familial. C’est dans ce contexte que la migration devient perçue comme un moyen d’échapper à cette impasse.
Les bas salaires et la précarité des emplois
Outre le chômage, les bas salaires et la précarité des emplois dans le secteur formel et informel sont des facteurs déterminants de l’émigration. Une large partie de la population active en Afrique, notamment dans des pays comme le Nigéria, l’Algérie, et le Cameroun, travaille dans le secteur informel, où les revenus sont souvent faibles et instables. Les conditions de travail précaires, sans protection sociale ni avantages, alimentent le désir de chercher de meilleures opportunités ailleurs.
Prenons l’exemple du Nigeria, l'une des plus grandes économies du continent, où une grande partie de la population active est occupée dans des emplois informels, tels que le commerce de rue, la petite restauration ou les services non réglementés. Selon certaines estimations, près de 80 % de la main-d'œuvre nigériane travaille dans l’économie informelle, sans filet de sécurité et avec des salaires peu élevés qui ne permettent pas une vie digne. Face à cette précarité, de nombreux jeunes nigérians voient l'émigration comme une solution pour obtenir un emploi plus stable et plus rémunéré, souvent dans les pays du Golfe, en Europe ou en Amérique du Nord.
Les salaires faibles sont également exacerbés par une croissance démographique rapide qui génère un surplus de main-d'œuvre. Le marché du travail africain est saturé, et les offres d’emplois ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande des jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail. Cette saturation crée un environnement compétitif, où les chances d’obtenir un emploi de qualité sont minimes. Le contraste est frappant : dans de nombreux pays africains, les jeunes diplômés sont souvent confrontés à des salaires plus bas que ceux d’autres régions du monde, ce qui les pousse à migrer dans des pays où les conditions économiques sont jugées meilleures.
Les inégalités de développement : disparités entre régions et inégalités sociales
L'Afrique est marquée par de profondes inégalités économiques, tant entre pays qu’au sein des pays eux-mêmes. Les écarts de développement entre les grandes zones urbaines et les régions rurales exacerbent cette situation et alimentent l’émigration. Par exemple, des pays comme l’Afrique du Sud, le Nigéria et le Kenya, qui possèdent des villes telles que Johannesburg, Lagos ou Nairobi, sont le reflet de contrastes économiques saisissants. Dans ces grandes métropoles, une partie de la population bénéficie d'une croissance économique plus rapide, de meilleures infrastructures, et de meilleures conditions de vie. Cependant, dans les zones rurales, une grande partie de la population vit dans une pauvreté extrême, avec un accès limité aux services de base comme l'éducation, la santé, et l'eau potable.
Les régions rurales, souvent en proie à la désertification, aux conflits ou à des systèmes de gouvernance défaillants, sont laissées pour compte, ce qui pousse les jeunes des campagnes à migrer vers les villes à la recherche de meilleures opportunités. Par exemple, dans des pays comme le Niger, le Mali ou le Burkina Faso, les zones rurales souffrent de conditions de vie difficiles en raison de la pauvreté extrême, du manque d’infrastructures et du faible accès aux services. Les jeunes de ces régions, souvent désabusés par l'absence de perspectives d'avenir, migrent vers les villes ou cherchent à traverser les frontières pour rejoindre des destinations perçues comme plus favorables, comme l’Europe ou les États-Unis.
En outre, les inégalités sociales croissantes, alimentées par des systèmes de gouvernance souvent sans résultat et corrompus, exacerbent cette dynamique migratoire. Les inégalités entre les riches et les pauvres, la concentration de la richesse et des ressources dans les mains d'une élite, et la faible redistribution des ressources créent un sentiment d’injustice parmi les populations vulnérables. Ce sentiment d'inégalité pousse ceux qui sont marginalisés à chercher un avenir plus équitable ailleurs.
Les facteurs économiques constituent un moteur puissant de l’émigration africaine, alimenté par des taux de chômage élevés, des bas salaires, et des inégalités de développement flagrantes. Les jeunes Africains, confrontés à un manque d’opportunités et à une précarité croissante, sont poussés à chercher une vie meilleure à l’extérieur du continent, espérant trouver un emploi stable et bien rémunéré dans des pays perçus comme offrant de meilleures conditions économiques. Face à ces défis, il est essentiel que les pays africains développent des politiques visant à améliorer les perspectives économiques locales, à créer des emplois décents et à réduire les inégalités régionales et sociales pour limiter l'émigration massive et favoriser un développement plus inclusif et équitable.
2. Facteurs politiques : instabilité, corruption, mauvaise gouvernance
Les facteurs politiques constituent un ensemble de causes profondes et puissantes qui alimentent l’émigration en Afrique. L’instabilité politique, la guerre, la corruption et la mauvaise gouvernance sont des problèmes qui non seulement affectent le développement économique des pays africains, mais aussi menacent la sécurité et la vie des citoyens, les poussant à fuir vers des endroits perçus comme plus sûrs et offrant de meilleures perspectives.
Instabilité politique, guerre et conflits armés
L’instabilité politique et les conflits armés sont des moteurs majeurs de l'émigration forcée à travers l'Afrique. Certaines régions du continent, comme le Sahel, la Corne de l’Afrique, et l'Afrique centrale, ont été particulièrement marquées par des crises politiques qui ont entraîné des déplacements massifs de populations. Ces conflits violents ne se limitent pas aux zones de guerre, mais touchent également les pays voisins, engendrant des crises humanitaires majeures et forçant des millions d’Africains à chercher refuge ailleurs.
Prenons l'exemple du Sahel, une région qui connaît une instabilité croissante depuis plusieurs années. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso, et le Niger sont confrontés à des insurrections islamistes et à des violences ethniques qui déstabilisent gravement la région. Ces violences ont déplacé des centaines de milliers de personnes qui fuient les attaques des groupes armés pour se réfugier dans les pays voisins comme le Mauritanie, le Tchad, et le Mali. La situation est exacerbée par la pauvreté et le manque de ressources dans ces pays, ce qui rend la vie encore plus précaire pour les déplacés.
Un autre exemple tragique est la guerre civile en République Démocratique du Congo (RDC), un conflit qui dure depuis plus de deux décennies et qui a entraîné la mort de millions de personnes et déplacé des millions d'autres. Le manque de sécurité, les violations des droits humains, et l'absence d’un gouvernement stable ont poussé des Congolais à chercher refuge dans les pays voisins comme l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya. Le cas de la RDC démontre l’urgence dans laquelle certains Africains se trouvent, contraints de fuir pour sauver leur vie.
De même, la guerre civile en Éthiopie, qui a éclaté dans la région du Tigré en 2020, a créé une crise humanitaire majeure. Des milliers de personnes ont perdu leurs vies, et des centaines de milliers d'autres ont été déplacées, cherchant refuge dans des pays comme le Soudan. La persistance de tels conflits ne fait qu’aggraver la situation politique et économique dans ces régions, créant un cercle vicieux qui pousse les populations à migrer en masse, souvent dans des conditions dramatiques.
Dans ces contextes de guerre et d'instabilité, l'émigration devient une question de survie. Les personnes forcées de quitter leurs foyers n'ont d'autre choix que de se rendre dans des camps de réfugiés ou d’entreprendre des voyages périlleux à travers des frontières parfois dangereuses, comme ceux qui tentent de rejoindre l'Europe ou d'autres pays d'Afrique.
Mauvaise gouvernance et corruption
En dehors des conflits ouverts, la mauvaise gouvernance et la corruption jouent également un rôle déterminant dans les migrations africaines. Dans de nombreux pays africains, la mauvaise gestion des ressources publiques, le manque de transparence et la corruption systémique entravent le développement économique et social, aggravant les inégalités et la pauvreté. Ce phénomène de mauvaise gouvernance pousse les citoyens à fuir, cherchant des pays où les institutions sont plus solides, où il existe une véritable séparation des pouvoirs, et où l'État de droit est respecté.
La corruption dans les administrations publiques est un fléau qui pénalise les citoyens dans de nombreux pays africains. Par exemple, en République Centrafricaine, la corruption des élites politiques et militaires a contribué à une gestion désastreuse des ressources naturelles et des financements publics, empêchant tout développement durable. Ces pratiques ont engendré une société fracturée où une petite élite accapare la richesse et les opportunités, tandis que la majorité de la population vit dans la pauvreté, sans accès aux services de base tels que l’éducation, la santé, et l’infrastructure. Les jeunes, particulièrement les plus éduqués, perçoivent l’absence de perspectives dans leur propre pays comme un frein à leur avenir, et sont souvent contraints de chercher de meilleures opportunités à l’étranger.
En Côte d'Ivoire, malgré des progrès économiques dans les années 2000, la corruption au sein des élites politiques a sérieusement freiné le développement du pays. Le manque de transparence dans les affaires publiques et l’exploitation des ressources naturelles par une minorité a alimenté un sentiment général de frustration parmi la population, poussant de nombreux jeunes à migrer pour fuir le système défaillant et chercher des opportunités dans des pays où ils estiment que leurs compétences et leur travail seront mieux récompensés.
Le cas du Zimbabwe est également représentatif de l’impact négatif de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gestion économique et la corruption ont entraîné une hyperinflation dévastatrice et une crise économique sans précédent, poussant des millions de Zimbabwéens à migrer, principalement vers l’Afrique du Sud, dans l'espoir de trouver un avenir plus stable et prospère.
La gouvernance défaillante et l’absence de mécanismes démocratiques fiables
Dans plusieurs pays africains, l'absence de mécanismes démocratiques solides et l’absence d'un véritable État de droit aggravent la situation politique. L’instabilité des régimes politiques, le manque de respect des droits de l'homme, et les répressions violentes à l'encontre des opposants sont des réalités quotidiennes dans des pays comme le Soudan, la République Démocratique du Congo.... Dans ces contextes, de nombreux Africains estiment qu'il est plus sûr de partir vers des pays où la stabilité politique et le respect des droits humains sont mieux garantis.
Dans des pays comme le Cameroun, où la répression des mouvements politiques et des opposants est fréquente, de nombreux activistes et jeunes désillusionnés choisissent de fuir en raison de l’intolérance politique et de la répression systématique. Ces conditions de gouvernance défaillante ont conduit à un exode de nombreux talents et compétences, créant ainsi un cercle vicieux où la fuite des cerveaux et le départ de ceux qui pourraient aider à renforcer la gouvernance et les institutions du pays aggravent encore les défis politiques internes.
L’instabilité politique, la guerre, les conflits ethniques, la mauvaise gouvernance et la corruption sont des facteurs cruciaux qui alimentent l’émigration en Afrique. La guerre et les conflits armés forcent des millions d'Africains à fuir leur pays, cherchant refuge dans des pays voisins ou plus éloignés, souvent dans des conditions extrêmement précaires. Parallèlement, la mauvaise gouvernance et la corruption institutionnalisée, qui caractérisent plusieurs pays africains, créent un climat de méfiance et de frustration parmi les populations, les incitant à chercher un avenir meilleur dans des pays où la stabilité politique et économique est plus garantie. Pour résoudre ces causes profondes de l’émigration, il est impératif que les gouvernements africains adoptent des politiques visant à renforcer la gouvernance, promouvoir la transparence, lutter contre la corruption et établir des systèmes démocratiques stables qui offrent des perspectives durable aux jeunes et à la population dans son ensemble.
3. Facteurs sociaux et environnementaux : conflits ethniques, changement climatique
Les facteurs sociaux et environnementaux jouent un rôle crucial et de plus en plus évident dans l’émigration africaine. Si l’on peut facilement associer les flux migratoires à des causes économiques ou politiques, il ne faut pas sous-estimer l’impact des facteurs sociaux, tels que les conflits ethniques, et des bouleversements environnementaux, comme le changement climatique. Ces deux facteurs ont des conséquences dramatiques sur la vie quotidienne des populations africaines, les forçant à chercher un refuge ailleurs, souvent dans des conditions extrêmement difficiles.
Conflits ethniques et tensions communautaires
Les conflits ethniques et les tensions entre communautés, exacerbées par des politiques discriminatoires et des gouvernements faibles, constituent l'une des causes sociales majeures de l'émigration en Afrique. De nombreux pays africains sont caractérisés par une mosaïque ethnique complexe où les groupes sociaux sont souvent en compétition pour l'accès aux ressources, à l'enseignement, ou au pouvoir politique. Quand ces tensions dégénèrent en violences interethniques ou en persécutions ciblées, des milliers, voire des millions de personnes, se retrouvent contraintes de fuir.
Un exemple emblématique de ce phénomène est la guerre civile qui a défiguré la République Démocratique du Congo (RDC) depuis la fin des années 1990. Les conflits ethniques, exacerbés par des intérêts géopolitiques et des luttes pour le contrôle des ressources naturelles (comme le cobalt et le coltan), ont entraîné des massacres et des déplacements massifs. La population du Kivu, par exemple, a été victime d'attaques récurrentes de groupes armés, souvent associés à des rivalités ethniques, poussant des millions de Congolais à fuir vers les pays voisins, comme l'Ouganda et le Rwanda. Les violences interethniques, la destruction des villages et l’instabilité politique dans ces zones de conflit ont fait de l’émigration une option inévitable pour ceux qui cherchent à échapper aux persécutions.
Un autre exemple est la crise au Soudan du Sud, où la guerre civile déclenchée en 2013 a été en grande partie alimentée par des tensions ethniques entre les Dinka, soutenus par le gouvernement, et les Nuer, dont une grande partie a rejoint la rébellion. Des massacres et des exécutions ciblées ont obligé des millions de Soudanais du Sud à fuir vers des pays voisins comme l’Ouganda et le Kenya. Les violences interethniques ont non seulement dévasté des communautés entières mais ont également donné lieu à un grand nombre de réfugiés qui cherchent désespérément des conditions de vie plus sûres et stables ailleurs.
Le cas du Darfour au Soudan est aussi un exemple tragique de persécutions ethniques systématiques. À partir de 2003, des violences ethniques entre les groupes arabes et non arabes ont conduit à des déplacements massifs. Les attaques ciblées contre des communautés non arabes ont poussé des centaines de milliers de personnes à fuir vers le Tchad ou l’Égypte, souvent dans des conditions précaires.
Les conflits ethniques engendrent des déplacements internes et internationaux massifs. Les populations appartenant à des minorités, qu’elles soient ethniques, religieuses ou même linguistiques, se retrouvent souvent prises pour cible. Ces groupes vulnérables sont contraints de quitter leur pays, non seulement pour échapper à la violence, mais aussi pour éviter la marginalisation et les discriminations quotidiennes, qui les empêchent de mener une vie normale dans leur propre pays.
Changement climatique et migrations forcées
Le changement climatique constitue un autre facteur majeur et souvent négligé dans les dynamiques migratoires en Afrique. Les conséquences du réchauffement de la planète, comme la désertification, la sécheresse prolongée, la diminution des ressources en eau et les conditions climatiques extrêmes, sont particulièrement visibles dans les régions africaines les plus vulnérables, comme le Sahel. Cette région, déjà marquée par une pauvreté structurelle, fait face à une crise environnementale majeure qui touche directement les conditions de vie de millions de personnes.
La désertification dans le Sahel est l'un des exemples les plus frappants des effets du changement climatique. La perte de terres arables et l’extension du désert du Sahara rendent la région de plus en plus inhabitable pour les populations locales, principalement des éleveurs et des agriculteurs. Ces communautés qui dépendent de l’agriculture et de l’élevage pour leur subsistance se retrouvent face à une grave pénurie de ressources naturelles, leur forçant à chercher de nouvelles terres ou à migrer vers des régions urbaines, ou encore vers d'autres pays, pour survivre.
Par exemple, les communautés du Tchad, du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont fortement affectées par l’avancée du désert. Les pâturages devenant de plus en plus rares, les éleveurs sont contraints de se déplacer avec leurs troupeaux, ce qui entraîne des tensions avec d’autres groupes ou même des conflits pour l'accès aux ressources. Les migrations environnementales deviennent ainsi un phénomène à la fois interne, à travers les frontières régionales, et international, notamment vers l’Europe ou d'autres pays d'Afrique subsaharienne.
En outre, la hausse des températures et l’acidification des océans, deux effets du changement climatique, affectent également les communautés côtières en Afrique. Par exemple, dans les îles Comores, aux Maldives ou dans d'autres régions côtières, l'élévation du niveau de la mer menace de submerger des terres agricoles et des habitations. Les populations de ces zones sont forcées de migrer vers l’intérieur du continent ou vers d'autres pays insulaires pour échapper aux inondations constantes. Le changement climatique devient ainsi un moteur indirect mais puissant de l’émigration, car il prive ces populations de leurs moyens de subsistance et les oblige à chercher des terres plus hospitalières.
L’Afrique centrale et l’Est, des régions déjà vulnérables aux catastrophes naturelles, connaissent également de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes. En Somalie, par exemple, la sécheresse a été exacerbée par l’instabilité politique, aggravant la famine et forçant des milliers de Somaliens à fuir vers les camps de réfugiés au Kenya, ou à entreprendre un périple vers l’Europe. Le changement climatique agit ainsi en catalyseur de déplacements internes et internationaux, car les populations ne peuvent plus vivre sur des terres devenues stériles ou invivables.
Le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC, 2021) souligne que les pays africains, en particulier ceux d'Afrique subsaharienne, sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique, malgré une faible contribution historique aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cette injustice climatique crée une situation de migration forcée, dans laquelle les populations les plus touchées n’ont pas la capacité de s’adapter et doivent quitter leurs terres pour survivre.
Les facteurs sociaux et environnementaux jouent un rôle central dans les dynamiques migratoires africaines. Les conflits ethniques, exacerbés par des politiques d'exclusion et de discrimination, poussent des millions de personnes à fuir leurs foyers, souvent dans des conditions dramatiques. Parallèlement, le changement climatique a ajouté une nouvelle dimension aux migrations en Afrique, en rendant certaines régions totalement inhabitées ou inadaptées à la vie humaine. Les populations, notamment les agriculteurs et les éleveurs, sont contraintes de migrer pour trouver des terres agricoles viables ou des ressources en eau, souvent dans un contexte de tensions avec d’autres communautés. Face à ces facteurs sociaux et environnementaux, il est urgent de mettre en place des stratégies de gestion des migrations qui tiennent compte de ces causes profondes et de trouver des solutions durables pour améliorer la stabilité et la résilience des régions les plus vulnérables en Afrique.
4. Le rôle des diasporas et l’influence des réseaux sociaux
Les phénomènes migratoires en Afrique sont profondément influencés par les diasporas et les réseaux sociaux. Ces deux facteurs, bien que souvent perçus comme étant relativement distincts, interagissent de manière complexe pour encourager de nouvelles vagues de départs. Si les diasporas africaines ont toujours été un acteur clé dans l'émigration du continent, l’influence croissante des réseaux sociaux a considérablement changé la dynamique et la perception de la migration en Afrique, rendant cette dernière plus attrayante et plus accessible que jamais.
Le rôle des diasporas africaines
Les diasporas africaines, ces communautés d’Africains vivant dans des pays étrangers, jouent un rôle important en facilitant la migration de nouveaux arrivants, mais aussi en exerçant une influence sur les dynamiques économiques et sociales des pays d’origine. Une fois installés dans des pays d’accueil, les migrants jouent souvent le rôle d’intermédiaires pour ceux qui souhaitent suivre leur exemple. Le phénomène de la migration devient ainsi un processus cumulatif et interconnecté.
L’un des aspects les plus importants du rôle de la diaspora est l’envoi de fonds aux pays d'origine, connu sous le nom de "transferts de fonds". Ces transferts représentent une part significative du revenu de nombreux ménages africains, et ont un impact direct sur l’économie des pays d’origine. Selon la Banque mondiale, les transferts de fonds envoyés par les diasporas africaines ont atteint environ 85 milliards de dollars en 2020, un montant supérieur à l'aide publique au développement reçue par le continent. Cela permet d’améliorer le niveau de vie des familles restées sur place, tout en réduisant la pauvreté et en soutenant l’économie locale. Cependant, cet afflux d’argent contribue également à alimenter le désir d’émigration chez d'autres membres de la communauté, qui voient la migration comme un moyen de sortir de la précarité.
Prenons l’exemple de la diaspora sénégalaise, particulièrement présente en France. Les Sénégalais établis à l’étranger envoient régulièrement des fonds à leurs familles, ce qui permet d’améliorer les conditions de vie des bénéficiaires au Sénégal. Cela renforce l'idée que partir à l'étranger est une manière efficace d'améliorer sa situation financière, créant ainsi un phénomène d’imitation au sein de la communauté. De plus, les membres de la diaspora servent de points de contact pour ceux qui souhaitent migrer. Ils offrent des informations pratiques sur les démarches administratives, le marché du travail, et même parfois une aide financière pour la traversée des frontières. Ce phénomène crée un cercle vicieux : plus il y a de migrants qui réussissent à s’établir et à envoyer de l’argent, plus cela encourage d’autres à emboîter le pas.
L’impact de la diaspora n’est pas uniquement économique. Elle joue également un rôle dans la formation d’un réseau d'entraide, qui permet aux nouveaux arrivants d’intégrer plus facilement la société d'accueil. En témoignant de leurs réussites et en offrant des conseils pratiques, les membres de la diaspora deviennent des modèles à suivre, renforçant ainsi l'idée que la migration est une voie vers un avenir meilleur.
L’influence des réseaux sociaux
Parallèlement au rôle de la diaspora, l'essor des réseaux sociaux a transformé la manière dont les jeunes Africains perçoivent la migration et les opportunités qui existent ailleurs. Les plateformes numériques comme Facebook, Instagram, Twitter, et YouTube jouent un rôle central dans la diffusion de récits de réussite et dans la construction d'un imaginaire collectif qui valorise l'idée de partir à l'étranger. Ces réseaux sociaux permettent aux jeunes d’être exposés aux réussites d’autres migrants et à des histoires qui véhiculent une image positive de la vie à l’étranger.
Les récits partagés sur les réseaux sociaux influencent particulièrement les jeunes générations, qui aspirent à améliorer leurs conditions de vie. Par exemple, sur Instagram, des influenceurs africains, souvent originaires de pays comme le Nigéria, le Ghana ou le Kenya, partagent leurs expériences de vie à l'étranger, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou dans d’autres régions du monde. Ces images de succès, qu’il s’agisse de carrière professionnelle, de réussite financière, ou de parcours académique, créent un désir d'émulation et rendent la migration encore plus attractive. Les jeunes Africains, surtout ceux des grandes villes et des zones urbaines, se retrouvent exposés à des récits qui véhiculent l’idée qu’une vie meilleure est à portée de main, dans des pays où les conditions de travail, la qualité de l'éducation, et le niveau de vie sont perçus comme bien supérieurs à ceux du pays d’origine.
Les plateformes telles que YouTube, par exemple, sont utilisées par de nombreux jeunes Africains pour publier des vidéos documentant leur vie dans les pays d'accueil, leur travail, leurs études, et leurs activités quotidiennes. Ces vidéos, souvent accompagnées de conseils pratiques sur la manière d’immigrer légalement et de s’adapter à un nouveau pays, deviennent des ressources précieuses pour ceux qui souhaitent partir. Les jeunes se connectent ainsi à une communauté internationale et échangent des informations sur les processus d'immigration, les obstacles à surmonter, et les opportunités économiques à l’étranger.
Les réseaux sociaux jouent également un rôle clé dans la visibilité des conditions de vie dans les pays d’accueil. Par exemple, les jeunes qui souhaitent émigrer peuvent facilement comparer les conditions de vie dans différentes régions du monde. Les vidéos, photos et témoignages partagés sur des plateformes comme Facebook ou Twitter permettent de briser les frontières géographiques et de rendre visibles les réalités de la vie dans des pays comme la France, l'Allemagne ou le Canada. Ces plateformes créent une représentation idéalisée de ces pays comme étant des lieux d'opportunités et de progrès.
Cette influence numérique a un effet amplificateur sur les aspirations migratoires. Les jeunes Africains, en particulier ceux vivant dans des zones urbaines où les infrastructures sont souvent inadéquates, peuvent voir la migration comme un moyen presque inévitable de trouver une meilleure qualité de vie. Cependant, cette représentation des pays d’accueil, souvent idéalisée, masque les défis et les difficultés auxquels sont confrontés les migrants une fois arrivés, comme la précarité de l'emploi, le racisme ou les obstacles à l'intégration. Néanmoins, cette vision positive est suffisamment forte pour encourager un nombre important de jeunes à prendre la route, souvent en ignorant les risques inhérents à la migration.
Les diasporas africaines et l'influence des réseaux sociaux sont désormais des moteurs essentiels de l’émigration depuis l'Afrique. Les diasporas, par le biais des transferts de fonds et des réseaux d'entraide, jouent un rôle central dans l'augmentation des départs, créant un cercle vertueux où chaque migration réussie inspire de nouveaux départs. Parallèlement, les réseaux sociaux offrent une visibilité accrue des conditions de vie à l’étranger, créant une vision idéalisée des pays d’accueil et encourageant ainsi de nombreuses personnes à tenter leur chance. Si ces facteurs jouent un rôle crucial dans le phénomène migratoire, ils rendent aussi la migration plus attrayante et accessible, renforçant un phénomène qui semble de plus en plus irréversible.
Conclusion
Les causes profondes de l’émigration africaine sont multiples et interconnectées. Des facteurs économiques tels que le chômage et les bas salaires, combinés à des facteurs politiques comme l’instabilité et la corruption, créent un environnement où la migration devient perçue comme la seule solution pour un avenir meilleur. Les facteurs sociaux et environnementaux, comme les conflits ethniques et les effets du changement climatique, exacerbent encore cette dynamique. Enfin, les diasporas et l'influence des réseaux sociaux jouent un rôle clé en renforçant l’envie de partir, et en facilitant le processus pour de nombreux Africains. Afin de répondre à cette crise migratoire, il est essentiel d’adopter des solutions durables et globales qui prennent en compte ces causes profondes, tout en cherchant à améliorer les conditions économiques, politiques et sociales en Afrique.
References
- Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2020). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. Guilford Press.
- OIM (2023). World Migration Report 2023.
- ILO (2021). World Employment and Social Outlook: Trends 2021.
- GIEC. (2021). Sixth Assessment Report: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Nos actualités
Découvrez nos dernières publications et actualités.

Conférence de Presse du REGEMaC : Gouvernance Efficace, Paix et Stabilité au Cœur des Débats
Domaine: Communiqué
Le Réseau des Experts en Gouvernance de l'État et Management des Crises (REGEMaC) organise une conférence de presse le 20 octobre 2024 à l'Agora Senghor, sous le thème "Gouvernance Efficace, Paix et S...
Lire plus
Inauguration du REGEMaC : Un Nouveau Réseau d’Experts pour Renforcer la Gouvernance et la Gestion des Crises
Domaine: Associatif
Le 11 août 2024 a marqué une étape importante dans le paysage institutionnel avec l’inauguration du Réseau des Experts en Gouvernance de l’État et Management des Crises (REGEMaC). Cet événement, qui s...
Lire plus
Genèse du REGEMaC : Une Réponse à la Nécessité d’une Gouvernance Efficace et d’une Gestion Proactive des Crises
Domaine: Associatif
L’idée de créer le Réseau des Experts en Gouvernance de l’État et Management des Crises (REGEMaC) est née d'une réflexion profonde sur les défis croissants auxquels sont confrontées les sociétés conte...
Lire plus